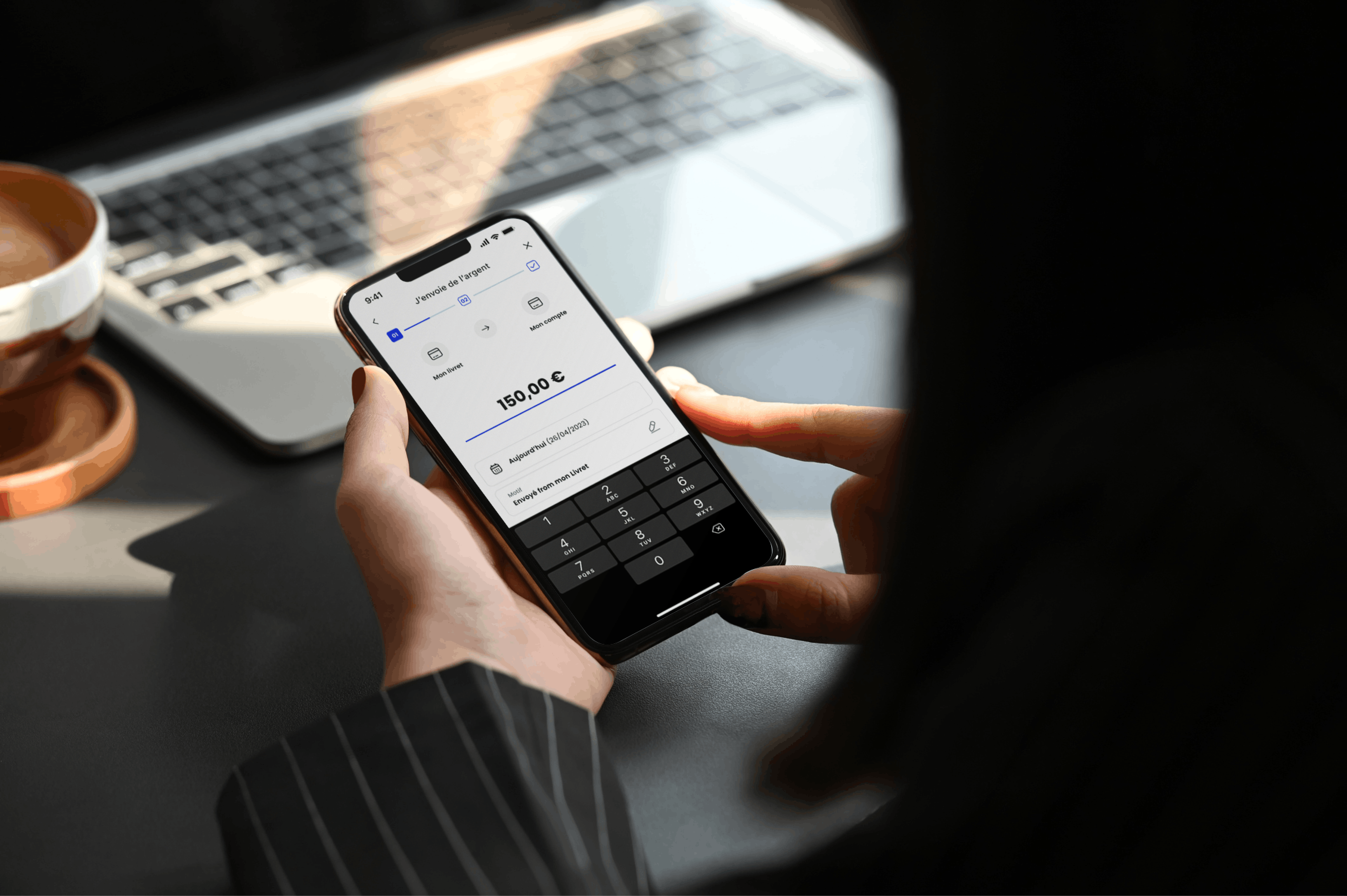BforMag
“Parlons tendances”
Parce que vous avez toujours un train d’avance, nous vous éclairons sur les tendances du secteur bancaire et fintech. Crypto-monnaies, intelligence artificielle, transactions numériques, nous explorons et analysons les tendances de demain à la loupe.
Nos derniers articles
- Parlons tendances
Comment savoir si je suis bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie en déshérence ?
Sans le savoir, vous êtes peut-être le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie non réclamé. On vous explique comment le vérifier facilement.
Lire la suite - Parlons tendances
Comment les Français épargnent-ils en 2025 ?
Les Français sont nombreux à épargner et le font surtout pour anticiper la retraite. La sécurité est selon eux la qualité première d’un bon placement.
Lire la suite - Parlons tendances
Partir à la retraite à 40 ans ? On décrypte pour vous le mouvement FIRE.
Prendre sa retraite à 40 ans, un rêve inaccessible ? C'est la promesse du mouvement FIRE. On décrypte pour vous cette méthode qui bouscule les codes de l'épargne.
Lire la suite - Parlons tendances
Fashion Week : combien ça coûte vraiment d'y assister ou d'y participer ?
La semaine de la mode, ou Fashion Week, se déroule chaque saison dans les villes qui sont considérées comme des capitales de la mode : Paris, mais aussi New York, Londres et Milan. Ces rendez-vous permettent aux grandes maisons de présenter, chaque saison, leur nouvelle collection au monde entier.
Lire la suite - Parlons tendances
La VOP (verification of payee) : la nouvelle obligation concernant les virements
Les virements bancaires en quelques clics et en quelques secondes, c’est pratique. Mais être sûr qu’ils soient sécurisés, c’est encore mieux ! C’est justement l’objectif de la VOP (Verification of Payee), un nouveau dispositif européen qui entrera en vigueur le 9 octobre 2025 pour garantir que l’IBAN correspond bien au nom du bénéficiaire.
Lire la suite - Parlons tendances
5 idées de séries et films à regarder sur l’argent
Envie de vous divertir tout en réfléchissant à l’argent ? Voici 5 séries à regarder sur les finances, la réussite, les dérives et les enjeux économiques.
Lire la suite - Parlons tendances
Location touristique entre particuliers : comment éviter les pièges de la location ?
Les locations de vacances entre particuliers continuent de se développer à une vitesse croissante. Aperçu des avantages de cette formules… et des pièges à éviter.
Lire la suite - Parlons tendances
Euro numérique : tout ce qu’il faut savoir sur la future monnaie digitale européenne
L’Europe avance sur un projet ambitieux : créer une version numérique de sa monnaie, l’euro. Supervisée par la Banque centrale européenne, cette initiative pourrait transformer nos habitudes de paiement. On vous explique tout !
Lire la suite - Parlons tendances
Fraude financière en recul : quelles nouvelles protections pour les consommateurs ?
Le 21 janvier 2025, la Banque de France a annoncé une belle baisse de la fraude aux moyens de paiement pour le premier semestre 2024. Plutôt encourageant, non ? On regarde ça de plus près !
Lire la suite - Parlons tendances
Co-living : vivre ensemble pour réduire ses coûts et créer du lien
Le co-living, une solution tendance pour réduire ses dépenses et tisser des liens sociaux : découvrez tous ses avantages !
Lire la suite